Ce que peut la littérature. Lire Charlotte Delbo
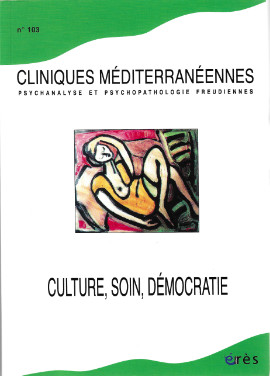
Essai 2021
Editions érès
Cliniques Méditerranéennes n°103 - Culture, soin, démocratie
Son début et quelques extraits de mon texte :
Au Fort de Romainville, tenu par les militaires allemands, sont emprisonnées depuis août 1942 des femmes arrêtées pour faits de Résistance. Un sous-officier allemand appelle, un mois plus tard, à la porte de leur dortoir dix-sept d’entre elles. Elles doivent rapporter à leurs compagnons, prisonniers de l’autre côté, le linge qu’elles leur raccommodaient. Elles reviennent, ne disent mot, le regard éteint. Le silence est lourd. Des amies s’approchent d’elles, les paroles chuchotées laissent entendre que, malgré le souci de la plupart des hommes de ne pas leur révéler leur sort, c’était un adieu. Ils seront fusillés le lendemain.
La scène est écrite par Charlotte Delbo dans "Une connaissance inutile" en ouverture du livre. Si je la rappelle c’est pour ce qu’elle dit de la fécondité d’une appropriation de la culture dans un moment tragique. Après le retour des femmes dans la chambrée et que le sort des hommes ne fait plus de doute, l’une d’entre elles se lève et propose dans le temps qui reste avant le coucher de se regrouper pour lire des poèmes. Des bancs sont rapprochés « C’était comme le premier repas après l’enterrement quand quelqu’un s’essaie à nouveau aux mots familiers et réussit à parler aux autres du boire et du manger. » Le mouvement collectif amorce une réparation à la douleur individuelle, apporte un liant dans les fractures intérieures. Ecouter un poème, le poème de Guillaume Apollinaire, "Matin des Morts" du recueil "Alcools", fera beaucoup plus. Charlotte Delbo cite quatre vers : « Car il n’y a rien qui vous élève/ Comme d’avoir aimé un mort ou une morte/ On est fortifié pour la vie/ Et l’on n’a plus besoin de personne », et ajoute : « chacune a su à l’atteinte de ces paroles que malgré le mensonge des hommes et l’hypocrisie du commandant avec le linge à rendre, chacune a su qu’elle avait eu tout de suite le sentiment de la mort et sa certitude. »
Il se passe quelque chose de tout à fait singulier, les vers révèlent une vérité jusque là cachée à soi-même. Chacune reçoit la confirmation de son intuition au moment où son nom fut appelé, le compagnon va être fusillé. Chacune refait corps avec elle-même, prend corps avec ce qui est devenu un destin à l’écoute du poème. Le pouvoir des vers est fort, à l’atteinte de ces paroles, précise Delbo, et elle ne révèle ni le nom de l’auteur du poème, ni son titre. C’est l’effet nu de la poésie, son pouvoir sans autre autorité, qui agit, qui fait du traumatisme de cet au revoir l’acceptation d’un destin. Les vers subliment la mort d’un proche, font de la douleur une force, de la perte d’un amour un honneur. (...) Jouir d’une forme d’art, écouter un poème, peut faire voir de plus loin que soi l’état qu’on traverse, peut permettre de le sublimer. Ici, les vers, dans leur cadence, unissent des thèmes qui s’opposent, la vie et l’amour avec la mort. Et l’harmonie, inattendue, provoque une émotion qui agrandit l’intime, en place de la douleur qui rétracte le cœur. (...)
Je crois que l’œuvre d’art a la capacité de transformer l’expérience que chacun fait de sa vie, de tout moment de sa vie. Et que cette capacité peut offrir un soulagement à l’expérience de vivre. Parce qu’elle en agrandit l’espace. Qui de tragiquement intérieur, s’allège, prend une autre dimension. Et peut s’illuminer un instant d’un sentiment de beauté.
J’en ai fait l’intense expérience en lisant l’œuvre de Charlotte Delbo. J’avais cherché une voix qui mette des mots sur la mort qui arrache les êtres les plus aimés. Sur la douleur que rien ne peut adoucir. Et sur les fantômes qui venaient autour de moi quand je pensais à la catastrophe d’Auschwitz. J’avais lu Primo Levi, j’avais gardé la puissance de l’œuvre de Robert Antelme, L’Espèce humaine. Sa lecture avait été une étape capitale dans mon chemin des mots. Puis j’ai lu Aucun de nous ne reviendra et les autres livres de Charlotte Delbo. Pour la première fois j’ai trouvé des mots qui avaient traversé la mort, des mots qui revenaient et m’apportaient une connaissance que j’attendais. Je rencontrais une écriture qui crevait la surface protectrice de la vie pour toucher l’âme, qui disait le corps qui souffre ce qu’un être humain ne doit pas souffrir. Qui prend des mots précis, simples, brise le rythme de la phrase et garde une syntaxe qui respecte l’architecture de la langue parce que la langue a une histoire qui la porte.
Charlotte Delbo a écrit avec une lucidité éprouvante les scènes vécues. Elle en a fait des tableaux aux arêtes coupantes. C’est un au-delà du monde, qui est dépeint, où ne s’entendent plus les cris d’épouvante de celles qui sont au bord des mourantes. L’épreuve de la lecture est métamorphosée par son écriture, le rythme, les mots choisis, ce qu’ils contiennent d’émotion, d’amour, de saisissante conscience. Les quelques images qui se détachent dans le récit agissent comme un baume sur le lecteur, au milieu du terrible qui est lu.
Peu de temps après leur arrivée au camp d’Auschwitz-Birkenau, depuis la soupente qui leur servait de lit, de table et de plancher comme elle l’écrit, elles regardent par la lucarne et découvrent sur la neige, dans la cour qui sépare leur block du suivant, des cadavres. Charlotte Delbo n’écrit pas le mot tout de suite. Il est absent des premières phrases parce que la conscience est lente à accepter ce qu’elle voit, et qu’il faudra un effort, comme un courage. Avant, il y a à écrire ce que le regard voit sans comprendre. Le rôle de la langue c’est aussi cela, d’apprivoiser les mouvements de la conscience, en dire le tâtonnement, la difficulté quand notre humanité vacille.
« D’abord, on doute de ce qu’on voit. Il faut les distinguer de la neige. Il y en a plein dans la cour. Nus. Rangés les uns contre les autres. Blancs, d’un blanc qui fait bleuté sur la neige. » Ce n’est que peu à peu que l’œil réalise ce qu’il voit. « Les têtes sont rasées, les poils du pubis droits, raides. Les cadavres sont gelés. Blancs avec les ongles marron. Les orteils dressés sont ridicules à vrai dire. D’un ridicule terrible. » L’ironie distancie l’effroi. Le sacrilège, les cadavres sans couverture, sans sépulture.
« Celles qui sont couchées là dans la neige, ce sont nos camarades d’hier.» Charlotte Delbo ouvre notre conscience, elle raconte, « elles » sur deux pages, les camarades, à l’appel, au travail dans les marais, leurs souffrances, la faim, les poux, les diarrhées, les coups endurés jusqu’à ne plus pouvoir tenir, les conditions de leurs ultimes luttes, puis leurs renoncements jusqu’à être emmenées dans ce mouroir qu’est le block d’à côté. Elle dit comment on les faisait encore sortir à coups de bâton pour l’appel, les vivantes y traînaient les mortes, qui après l’appel restaient dans la neige. Et l’horreur de ce qu’elles voyaient depuis la lucarne, l’arrivée des camions qui venaient prendre les vivantes pour les emporter à la chambre à gaz et les mortes aux fours crématoires, et le martyre de celles qui avaient échappé à ces prises et survivaient comme des spectres.
Une des compagnes dans la soupente voit une main bouger au milieu des cadavres. « Regardez. Oh, je vous assure qu’elle a bougé. Celle-là, l’avant-dernière. Sa main… ses doigts se déplient, j’en suis sûre. » L’épouvante est là, et Charlotte Delbo écrit : « Les doigts se déplient lentement, c’est la neige qui fleurit en une anémone de mer décolorée. » Je lis, et il me semble qu’une fleur s’épanouit au fond de moi où se mêlent mer et neige. Au moment où je lisais l’horreur, l’indignité infligée, des scènes qui me dessoudent de mon humanité, je ressens une émotion purement humaine, la conscience de la beauté. La beauté d’une image. Elle peut recueillir ma douleur, l’horreur ressentie à lire toute la scène et l’adoucir, comme si l’image était un onguent appliqué un instant sur la douleur, avec la douceur du mouvement lent dans l’eau des fines tentacules de l’animal marin, mouvement hypnotique, et l’anémone me fait croire à un hommage, la fleur qu’on dépose sur le mort, un rituel humain, qui une seconde arrête l’infernale succession d’indignités infligées.
Charlotte Delbo mêle à cette scène un souvenir d’enfance. C’était un jour de soleil et d’été, elle attendait son père à l’extérieur d’un grand magasin. Des manutentionnaires déchargent des mannequins destinés aux vitrines, les couchent précautionneusement sur le trottoir chaud. « Je n’avais jamais pensé qu’ils existaient nus, sans cheveux. (…) Le découvrir me donnait le même malaise que de voir un mort pour la première fois. » Alinéa. « Maintenant les mannequins sont couchés dans la neige, baignés dans la clarté d’hiver qui me fait ressouvenir du soleil sur l’asphalte. » Ce souvenir au milieu d’un tableau d’épouvante agrandit l’espace intérieur de la conscience, la profondeur du texte, lui donne une ligne de fuite et associe un autre temps. Ces registres différents permettent de lire la scène traumatisante en s’appropriant un espace pour sa conscience.
Je ne peux m’empêcher d’associer la conscience à un espace, certes un espace intérieur, mais il me faut de la place pour pouvoir mettre ensemble des choses si différentes que sont les choses vues, les choses apprises, mes émotions, mes sensations, mes associations. Et y ajouter le temps, le travail du temps, qui peut permettre de se constituer avec tout ce qui a pu s’agréger. Et si une œuvre littéraire peut travailler à me construire une conscience, c’est aussi parce qu’elle réussit à me faire une place. Oui, faire de la place à un lecteur agissant. Qu’on puisse « bouger » à la lecture, il faut de la place pour cela, et du temps pour soi, le temps de s’émouvoir de ce qui est reçu. Je vois le silence que Delbo introduit dans ses textes comme cette place pour la résonnance intérieure.
Elle utilise toute sorte de silences. Il y a celui qui nous est raconté, le leur, face à ce qu’elles voient, subissent, ce silence physique parce que la douleur, l’effroi gèlent le commentaire sur la situation vécue. Ce silence qui nous dit l’anéantissement de l’humain quand il n’y a plus d’expression, de langage. Et dans sa langue, elle introduit du silence. D’une phrase à une autre, par une ellipse. Elle interrompt une narration, livre à la phrase suivante l’effet de ce qui est raconté. Il y a ce silence net à la fin de chaque chapitre pour tenir en suspens l’intensité de la scène.
(...)
Lire l’œuvre de Charlotte Delbo c’est prendre un autre chemin que celui des images de l’extermination de masse. Celles qui ont montré les corps démantelés, l’amoncellement des cadavres. C’est raconter « nos camarades d’hier » derrière la vison de cadavres gelés rangés dans une cour. C’est remonter vers l’origine elle-même, faire voir des personnes. Comme toutes les personnes qui descendent d’un train qui vient d’un ghetto à l’est de l’Europe.
Le premier de ses livres sur sa déportation, elle choisit de le commencer non pas avec leur arrivée, - elles qui sont le seul convoi de femmes françaises déportées politiques à Auschwitz -, mais par l’arrivée d’un convoi de juifs. Ce qu’elle veut écrire ce sont les personnes qu’elle a vu descendre du train, quand elle est depuis quatre mois au camp et qu’elle sait ce qui s’y passe, ce qui s’échappe des cheminées jour et nuit. Elle veut faire voir toutes les personnes, si différentes les unes des autres, et leur histoire, qu’elle construit en quelques mots. Les mères avec leurs enfants, les grands parents, les fillettes d’un pensionnat avec leur maîtresse, les intellectuels qu’elle distingue à leur démarche, à leurs lunettes, médecins, compositeurs, poètes, dont elle imagine l’activité, et ce que disent leurs vêtements du moment où ils ont été raflés, de pays d’où ils viennent. Chacun porte sa vie avec soi, et la volonté de suivre ce qui est ordonné, pensant échapper à tout mauvais traitement après ces jours et ces nuits enfermés dans les wagons.
Elle dit les expressions des visages, exprime ce qui lui semble leurs pensées, elle leur restitue même un futur en disant ce qu’ils pensent raconter plus tard à leurs petits enfants sur leur arrivée dans ce lieu insolite, alors que nous savons, nous, parce ce que nous connaissons la suite, que tous ceux qui descendent du train, dans quelques heures, n’existeront plus. Et à la place de ce que nous a appris l’Histoire, la suite, le processus de l’extermination, l’organisation criminelle, les camions qui les attendent pour les conduire à la chambre à gaz, l’écrivain prend du temps, des pages pour écrire ceux qui descendent du train, et nous faire voir qui descend, qui est là, chacun dont elle fait revivre par quelques indices la vie particulière, et le tableau est d’une infinie diversité, à en donner le tournis, par le nom de tous ces noms de pays de l’est de l’Europe qu’elle évoque, ces métiers, ces âges, ces conditions si diverses, cette infinie diversité. Cette conscience de la diversité, cette insistance sur leur diversité, en plus de l’humanité qu’elle incarne, exprime l’exact opposé de la dissolution de la personne dans la masse, qui est le propre de la dictature. L’agissement des totalitarismes. Ce regard pour reconnaître l’existence des diversités est un acte qui est le signe et l’exigence de la démocratie.
(...)